La polarisation de l’Amérique, entre agonie des idées et résistance
Dans un climat saturé par la polarisation et les guerres culturelles, j'ai sélectionné quatre livres qui analysent la crise américaine en profondeur.
Si vous souhaitez que je continue à partager mes écrits en français, je vous serais reconnaissant de transmettre cette publication à trois amis et de les inviter à s’abonner.
- Yascha
Cet article a été publié pour la première fois en français dans Le Point le 28 septembre.
Pour les idées, la saison n’est pas très bonne aux États-Unis. La polarisation y dévore tout. Même ses plus grands auteurs s’échinent à célébrer, plus ou moins explicitement, la pureté de leur camp et la dépravation de celui d’en face. D’où des écrits politiques d’une monotonie assommante, et tout le reste relégué à l’insignifiance.
Le résultat, c’est une scène politique profondément transformée. Quand je suis arrivé aux États-Unis, le New Yorker faisait autorité : mes amis citaient l’un ou l’autre de ses articles dans presque chaque conversation. En savourer les tournures élégantes passait pour un signe de raffinement. Avec ses sujets éclectiques – un artiste obscur ici, l’univers insolite du tricot de compétition là –, la revue esquissait le séduisant tableau d’un pays pouvant se targuer de contenir la multitude.
Désert culturel
Aujourd’hui, le « New Yorker » n’est plus que l’ombre de lui-même. Il aligne des points politiques attendus, parfois faux, toujours convenus. Son style autrefois inimitable s’est dissous dans la banalité. Ses tribunes pourraient être copiées-collées dans n’importe quel autre journal sans qu’on y voie la différence. Ses portraits se bornent à ressasser les turpitudes de figures déjà honnies par son lectorat. Et quand, par miracle, un article digne de son âge d’or s’y glisse encore, il passe totalement inaperçu.
Voilà des mois que je n’ai pas entendu le New Yorker mentionné dans une conversation. De son prestige d’antan, il ne reste guère que ses tote bags, encore omniprésents à Brooklyn et dans quelques quartiers parisiens – dérisoires reliques d’une gloire éteinte.
Dans un tel désert culturel, que reste-t-il à écrire ? Existe-t-il encore, aujourd’hui, quelque chose venu des États-Unis qui mérite d’être lu au-delà de leurs frontières ?
Une relecture tranchante de l’été 2020
La réponse est oui. À l’heure actuelle, les meilleurs écrits américains sont ceux qui décrivent la déchéance du pays tout en contraignant le lecteur à affronter plusieurs vérités à la fois. Leurs auteurs savent reconnaître, sans détour, le danger et l’absurdité de l’administration actuelle, sans pour autant ignorer les conditions qui ont rendu possible la réélection de Donald Trump. Ils connaissent intimement la scène américaine, mais y ajoutent une perspective élargie – venue d’un autre pays, d’une autre carrière ou d’une autre discipline – qui donne à la crise une profondeur nouvelle.
Il n’est donc pas surprenant que l’un des essais les plus débattus de ces derniers mois ait été signé par un Américain vivant une bonne partie de l’année à Paris. Dans Summer of Our Discontent, Thomas Chatterton Williams propose une relecture tranchante de l’été 2020, quand les États-Unis – et une bonne partie du monde – s’embrasaient au nom d’un « grand moment de justice sociale ».
Fils d’une mère blanche et d’un père noir, enraciné dans la culture afro-américaine mais rétif aux étiquettes raciales simplistes qui corsètent la vie publique, Williams sait prendre toute la mesure de la colère collective née du meurtre de George Floyd. Tout en fustigeant sans ménagement les excès du mouvement qui a suivi, ayant vite dégénéré en émeutes dans de nombreuses villes, il pointe la faillite d’une classe dirigeante qui aura sacrifié sa crédibilité en troquant expertise et devoirs contre posture politique. Et il met sévèrement en garde contre le mouvement Maga – grand bénéficiaire de ces dérives – qui attise aujourd’hui les penchants les plus illibéraux de la culture américaine.
Que l’accueil réservé au livre de Williams ait été presque entièrement dicté par la politique en dit long sur l’air du temps. La presse de gauche, New York Times en tête, l’a cloué au pilori pour ses critiques des dérives de Black Lives Matter. Celle de droite, à commencer par le Wall Street Journal, l’a étrillé pour son intransigeance envers Donald Trump. Mais c’est justement son refus de laisser une appartenance politique ou ethnique infléchir son regard sur les maux de l’Amérique contemporaine qui fait la force de son écriture.
Une parabole américaine
George Packer, autre voix majeure des États-Unis d’aujourd’hui, a exploré ces contradictions sous une forme littéraire différente. On lui doit des ouvrages marquants sur l’intervention calamiteuse des États-Unis en Irak (The Assassins’Gate) et sur les forces centrifuges qui, rétrospectivement, ont ouvert la voie à l’ascension de Trump (The Unwinding). Il revient aujourd’hui à ses origines de romancier avec The Emergency, à paraître en novembre.
The Emergency raconte la révolution singulière touchant un univers fictif, assez proche des États-Unis contemporains pour que la parabole fasse sens, mais suffisamment décalé pour préserver la force de la fiction contre les assauts du didactisme. Ce pays imaginaire a longtemps vécu sous un ordre social apparemment stable, séparant bourgeois et paysans et distribuant les statuts professionnels dans de puissantes guildes au terme d’un examen rédouté. Jusqu’au jour où une série de bulles financières et d’expéditions étrangères désastreuses précipite une révolution inattendue. Ses protagonistes – un médecin respecté, pilier de l’ordre ancien, et sa fille, jeune révolutionnaire qui le méprise – se lancent alors dans une aventure mêlant film de potes, drame familial et expédition anthropologique à la découverte de leur pays. Une quête qui les oblige à se confronter à ce qu’ils sont et à l’avenir qu’ils peuvent encore espérer.
Piégés dans des conflits en apparence insolubles
La nécessité d’admettre nos différences sans les effacer est aussi le fil conducteur de l’un des meilleurs essais documentaires parus ces dernières années : High Conflict, d’Amanda Ripley. Journaliste aux multiples talents, elle y montre comment individus et groupes peuvent se retrouver piégés dans des conflits en apparence insolubles. Son enquête conduit le lecteur des guérilleros de gauche en Colombie aux gangs de rue des quartiers les plus pauvres de Chicago, jusqu’aux habitants d’une des villes les plus riches de Californie, déchirés par des luttes intestines.
Ripley montre que, derrière des conflits en apparence sans rapport, les ressorts sont les mêmes. Tout comme les issues possibles. Son propos n’est pas de rêver d’un monde sans conflit : une dose de confrontation est inévitable, et même salutaire, surtout en politique. Mais, lorsque les acteurs des affrontements les plus destructeurs prennent conscience de leurs coûts terribles et acceptent de comprendre l’histoire qui nourrit les peurs et la colère de leurs adversaires, il devient parfois possible de redescendre des sommets grisants de l’animosité mutuelle.
Les réseaux contre les hiérarchies
Une animosité qui, bien sûr, est en partie alimentée par les réseaux sociaux. Et l’ouvrage le plus influent sur le sujet, au cœur même de la Silicon Valley, reste The Revolt of the Public. Autopublié en 2014 par Martin Gurri, ex-analyste de la CIA, il s’est vite imposé comme une lecture incontournable pour les grandes figures de la tech californienne.
Gurri montre qu’Internet et les réseaux sociaux sapent la capacité des élites à imposer leurs opinions et leurs valeurs au reste de la société. Ces technologies favorisent systématiquement les réseaux contre les hiérarchies, la périphérie contre le centre, les forces centrifuges contre les forces centripètes. L’avenir, prédit-il, sera donc jalonné de « publics » éphémères, capables de se constituer en un instant et de renverser l’ordre établi. Sauf que ce public n’a pas d’objectifs durables : sa rébellion pourrait aboutir moins à un nouvel ordre politique qu’à l’impossibilité même d’en instaurer un.
Peut-être, après tout, que la scène littéraire américaine n’est pas aussi sinistrée qu’on le croit. Le pays produit encore de grands écrivains, des penseurs acérés, des idées stimulantes. Mais, pour l’heure, l’essentiel de cette vitalité se réfugie dans un entre-deux : celui d’esprits refusant de se plier aux tribus idéologiques et affrontant, chacun à sa manière, les crises de nerfs du pays. Consolation partielle seulement – bien loin de compenser la perte de l’oxygène culturel que j’avais découvert en m’installant ici.




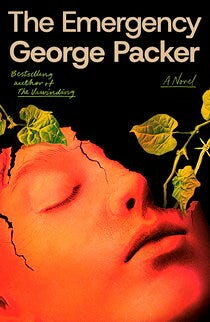
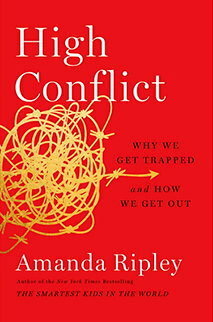
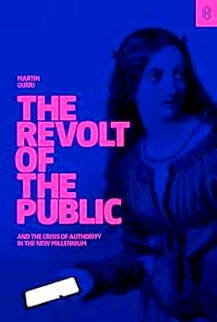
You need to realize the various reference points that different groups of Americans have. Start with the American history folks and look into the Age of Jackson and the expansion and of the electorate